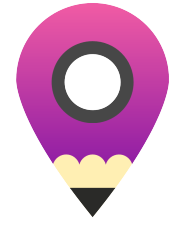POUR VOTRE INFORMATION.
Cette histoire a plus de 5 ans.
Voyage Collage de Matthew Leifheit
Collage de Matthew LeifheitUne nuit de l'hiver 1983, peu de temps avant mon départ pour Bangkok pour travailler sur un film, un ami m'a parlé d'un tueur en série connu sous le nom de « Bikini Killer », un beau voleur de pierres précieuses occasionnellement charismatique nommé Charles Sobhraj qui avait opéré de la Thaïlande au début des années 1970. Mon ami avait connu un couple de Formentera, faisant de la contrebande d'héroïne par relais en provenance d'Asie du Sud, qui avait été séparément entraîné à la mort. Ils étaient deux des nombreux touristes occidentaux que Sobhraj avait étouffés sur le soi-disant Hippie Trail. Ce chemin s'étendait de l'Europe à l'Asie du Sud, parcouru par des décrocheurs occidentaux alors qu'ils fumaient de l'herbe et se connectait avec les habitants. Sobhraj volerait à ces vagabonds assoiffés de spiritualité tout l'argent qu'ils possédaient, méprisant ce qu'il considérait comme leur morale lâche.
Les retards de production à Bangkok m'ont laissé à moi-même pendant plusieurs semaines. C'était une ville désorientante, malodorante, folle de la circulation et effrayante, pleine de moines mendiants, de gangs d'adolescents, de motos, de temples, de proxénètes meurtriers, de prostituées terrifiantes, de bars, de bars, de vendeurs de rue, de colonies de sans-abri et d'une pauvreté époustouflante. . Après avoir découvert que Captagon, une puissante amphétamine, était en vente libre, je me suis assis devant ma machine à écrire manuelle louée pendant 12 ou 14 heures d'affilée, à produire des poèmes, des entrées de journal, des histoires et des lettres à des amis. Le médicament a aidé l'écriture le long. Après une frénésie de vitesse, je me suis assommé avec du Mekhong, un whisky virulent qui contiendrait 10 pour cent de formaldéhyde et dont on dit qu'il cause des lésions cérébrales.
Lors de dîners avec des expatriés britanniques et français qui vivaient en Thaïlande depuis l'offensive du Têt, j'ai recueilli d'autres rumeurs sur Sobhraj. Il parlait sept langues. Il s'était évadé de prisons dans cinq pays. Il s'était fait passer pour un érudit israélien, un marchand de textile libanais et mille autres choses alors qu'il parcourait l'Asie du Sud à la recherche de touristes victimes en tant qu'homme de la drogue et du vol. Les personnes avec lesquelles il s'est lié d'amitié autour d'un verre se sont réveillées des heures plus tard dans des chambres d'hôtel ou des trains en mouvement, sans leurs passeports, leur argent, leurs appareils photo et autres objets de valeur.
À Bangkok, les choses avaient pris une tournure sombre. Sobhraj s'était fait un objet de passion pour une secrétaire médicale canadienne qu'il avait rencontrée à Rhodes, en Grèce, une femme nommée Marie-Andrée Leclerc, qui passait des vacances avec son fiancé. Leclerc a quitté son emploi, a largué son fiancé et s'est envolée pour Bangkok pour rejoindre Sobhraj. A son arrivée, il lui ordonna de se faire passer pour sa secrétaire ou sa femme, selon les circonstances. Sobhraj la baisait rarement, à son grand dam, et seulement lorsque son bon sens menaçait de dominer ses fantasmes romantiques fleuris.
Ils ont sillonné la campagne, drogué les touristes, les emmenant dans un état semi-comateux dans un appartement d'appoint loué par Sobhraj. Il les a convaincus que les médecins locaux étaient de dangereux charlatans et que sa femme, une infirmière diplômée, les aurait bientôt dans le rose de la santé. Parfois, il les gardait malades pendant des semaines, Leclerc leur administrant une «boisson médicinale» composée de laxatifs, d'ipéca et de Quaaludes, les rendant incontinents, nauséeux, léthargiques et confus, tandis que Sobhraj trafiqué leurs passeports et les utilisait pour traverser les frontières, dépenser leur argent , et clôturez leurs objets de valeur.
En 1975, il a rencontré un garçon indien nommé Ajay Chowdhury dans un parc. Chowdhury a emménagé avec Leclerc et Sobhraj, et les deux hommes ont commencé à assassiner certains « invités ». Les « assassinats en bikini » étaient particulièrement horribles, contrairement à aucun des crimes précédents de Sobhraj. Les victimes ont été droguées, conduites dans des zones reculées, puis matraquées avec des planches, aspergées d'essence et brûlées vives, poignardées à plusieurs reprises avant d'être égorgées, ou à moitié étranglées et traînées, respirant toujours, dans la mer.
Sobhraj avait déjà tué des gens, avec des overdoses accidentelles. Mais les Bikini Killings étaient différents. Ils étaient soigneusement planifiés et inhabituellement inélégants. Ils se sont déroulés sur une période étrangement comprimée entre 1975 et 1976, comme un accès de rage qui a duré plusieurs mois puis s'est mystérieusement arrêté. Sobhraj et Chowdhury ont massacré des personnes en Thaïlande, en Inde, au Népal et en Malaisie. On ne sait pas combien : au moins huit, dont deux homicides par incinération à Katmandou et une noyade forcée dans une baignoire à Calcutta.
Sobhraj a finalement été arrêté en 1976 à New Delhi, après avoir drogué un groupe d'étudiants ingénieurs français lors d'un banquet à l'hôtel Vikram. Il les a incités à prendre des « gélules anti-dysenterie », que beaucoup ont avalées sur-le-champ, devenant violemment malades quelques minutes plus tard. Le réceptionniste de l'hôtel, alarmé par 20 personnes ou plus vomissant partout dans la salle à manger, a appelé la police. Entièrement par hasard, l'officier qui s'est présenté au Vikram était le seul policier en Inde à pouvoir identifier de manière fiable Sobhraj, à partir de la cicatrice d'une appendicectomie réalisée des années plus tôt dans un hôpital pénitentiaire.
Jugé à New Delhi pour une longue liste de crimes, y compris le meurtre, Sobhraj n'a été condamné que pour des chefs d'accusation plus mineurs, suffisamment, supposait-on, pour assurer son éloignement de la société pendant de nombreuses années. A Bangkok, insomniaque à cause de la vitesse, j'ai commencé à soupçonner que Sobhraj n'était pas vraiment incarcéré dans une prison indienne comme le rapportent les journaux. J'étais assez paranoïaque pour penser que puisque je pensais à lui, il pensait aussi à moi. J'ai rêvé de lui pendant les rares heures où je dormais, imaginant sa silhouette souple et mortelle dans un bas de corps noir, rampant à l'intérieur des conduits d'aération et des conduits de ventilation de mon immeuble, comme Irma Vep.

Charles Sobhraj et Marie-Andrée Leclerc en 1986. Photo par REX USA
En 1986, après dix ans de prison, Sobhraj s'est échappé de la prison Tihar de New Delhi, aidé de ses codétenus et d'un gang qu'il avait constitué à l'extérieur. Il s'est échappé en droguant tout un poste de garde avec un cadeau festif composé de fruits dopés, de pâtisseries et d'un gâteau d'anniversaire. L'Inde, qui n'avait pas de traité d'extradition avec la Thaïlande lorsque Sobhraj a été arrêté en 1976, avait accepté d'honorer une ordonnance d'extradition spéciale après avoir purgé sa peine en Inde, une ordonnance non renouvelable valable 20 ans.
La Thaïlande avait des preuves de six meurtres au premier degré. Les Bikini Killings avaient ruiné l'industrie du tourisme pendant plusieurs saisons et Sobhraj s'était moqué de la police de Bangkok. Il était largement admis que s'il était extradé, il serait abattu en descendant de l'avion.
Il s'enfuit de Delhi à Goa. Il a bourdonné autour de Goa sur une moto rose, dans une série de déguisements absurdes. Finalement, il a été arrêté au restaurant O'Coqueiro, alors qu'il utilisait le téléphone. Le but de l'évasion avait été de se faire arrêter et de se voir infliger plus de peine de prison pour s'évader, juste assez pour dépasser la date d'expiration de l'ordre d'extradition thaïlandais.
Après des années d'intérêt sporadique pour Sobhraj, je voulais le rencontrer. Alors en 1996, j'ai proposé un article sur lui à Tournoyer . Je n'avais pas particulièrement envie d'écrire un article, surtout pas pour une version magnifiée de Battement de tigre , mais ils étaient prêts à payer, alors j'y suis allé.
J'ai d'abord contacté Richard Neville, qui avait passé beaucoup de temps avec Sobhraj lors de son procès à New Delhi. Neville avait écrit un livre, La vie et les crimes de Charles Sobhraj , et vivait maintenant dans une partie reculée de l'Australie. Il faisait encore des cauchemars à propos de Sobhraj. « Tu devrais aller satisfaire ta curiosité obscène, me dit-il, et ensuite t'éloigner le plus possible de cette personne et ne plus jamais avoir à faire avec lui.
Quand je suis arrivé à New Delhi, la peine de dix ans de prison de Sobhraj pour l'évasion était sur le point d'expirer, ainsi que l'ordonnance d'extradition. J'ai emménagé dans un hôtel bon marché appartenant à un ami d'un ami. J'ai souvent traîné au Press Club of India à Connaught Place, lieu de prédilection des journalistes de tout le pays. Le club ressemblait au hall d'un flophouse de Bowery vers 1960. Des assiettes de cacahuètes espagnoles frites dans des piments, le seul élément comestible du menu, étaient gratuites avec les boissons. Sur les murs se trouvaient des portraits de journalistes qui, après avoir quitté le Press Club ivre mort, s'étaient fait écraser dans la circulation.
Mes nouveaux collègues étaient pleins d'anecdotes effrayantes sur Sobhraj - des histoires de ses amitiés avec des politiciens et des industriels emprisonnés, des sommes fabuleuses qu'on lui avait offertes pour les droits cinématographiques de son histoire. UNE Temps de l'Hindoustan le correspondant m'a assuré que je n'irais jamais le voir. Sobhraj avait été mis en quarantaine de la presse, et les privilèges somptueux dont il avait jadis bénéficié dans la prison de Tihar avaient été coupés lorsque le nouveau directeur a pris le relais.
Le nouveau directeur était Kiran Bedi, une légende de l'application de la loi indienne. Ancienne championne de tennis, elle est devenue la première policière indienne. Elle était une féministe au franc-parler et, paradoxalement, une fervente partisane du parti de droite Bharatiya Janata. Fanatiquement incorruptible dans une force de police richement corrompue, elle avait reçu de nombreux « postes de punition » pour la décourager, mais elle appliquait un tel zèle littéral à ses emplois – ordonnant aux ministres d'État' des voitures garées illégalement remorquées, par exemple, qu'elle est devenue une héroïne nationale dont ses patrons ne pouvaient pas se débarrasser. Avant l'arrivée de Bedi's, Tihar était connue comme la pire prison d'Inde, ce qui n'est pas peu dire. Bedi a transformé sa mission de pénalité en un autre triomphe de relations publiques, transformant Tihar en un ashram de réadaptation, introduisant un régime inflexible de méditation matinale, de formation professionnelle et de cours de yoga.
Je me suis assis pendant des heures un matin dans la salle d'administration de la prison, près d'une vitrine d'armes confisquées. Des soldats apathiques passaient en bâillant et en se grattant les couilles. Un groupe excité de dames est arrivé, certaines en tailleur-pantalon, d'autres en saris, entourant une petite silhouette en blanc aveuglant plus quatre, avec une coupe de cheveux de butch et un poing serré d'un visage. C'était Bedi. Sur les conseils d'amis du Press Club, je lui ai dit que je voulais écrire un profil d'elle pour un magazine new-yorkais. Il n'a fallu que quelques instants en sa présence pour sentir l'immensité de son ego et de sa perspicacité.
J'étais la bienvenue pour passer du temps à la prison, dit-elle. Mais si je prévoyais de parler à Sobhraj, je pourrais l'oublier. Elle mettrait son travail en danger si elle laissait la presse lui parler. Que ce soit vrai ou non, j'étais certain qu'elle avait l'intention d'être la seule célébrité sur place. J'ai demandé comment allait Sobhraj.
« Charles a changé ! » déclara-t-elle avec l'accent aviaire et crépitant de l'anglais indien. « Par la méditation ! Il travaillera avec Mère Teresa à sa sortie ! Personne ne peut le voir maintenant, il est réhabilité ! Dans le souffle suivant, elle m'a suggéré de rester en Inde pendant plusieurs mois. Je pourrais très bien vivre là-bas, a-t-elle dit, si j'acceptais d'écrire son autobiographie en fantôme. Cela semblait bizarre.
Avant que je puisse respirer, j'ai été poussé à l'extérieur et entassé dans une voiture à bulbe qui filait le long du mur d'enceinte intérieur renfermant les quatre prisons distinctes de Tihar, un énorme complexe avec de nombreux espaces ouverts, ressemblant à une petite ville. Nous sommes arrivés à une tribune d'examen, où j'ai été conduit à la fin d'une rangée de dignitaires en tenue de soirée. Au-dessous de nous, 2 000 prisonniers étaient assis dans la position du lotus, beaucoup festonnés de poudre colorée. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais là, en jean déchiré et tee-shirt Marc Bolan. Le discours de Bedi's était une célébration de Holi, une fête religieuse hindoue encourageant l'amour, le pardon et le rire. Et de la poudre colorée smeary.
Après la cérémonie, nous sommes retournés au bureau. Bedi a annoncé qu'elle partait pour une conférence en Europe le lendemain pour plusieurs semaines. Désireuse pour moi, son nouveau biographe, d'obtenir le plein effet de l'ashram de Tihar, elle a griffonné un laissez-passer aux quatre prisons sur du papier brouillon. J'étais dedans. En quelque sorte.
Chaque matin pendant trois semaines, je me suis dirigé vers la prison de Tihar dans un taxi traversant des foules inexcitables et une circulation confuse, contournant des éléphants et des vaches cendrées et affamées. Tout scintillait dans la chaleur épouvantable. Nous avons passé le Fort Rouge, l'air gras de smog jaune et la fumée noire des feux d'essence. Des mendiants s'accroupissaient dans les marais à côté de la route, chiant franchement en regardant la circulation.
Mon laissez-passer était inspecté chaque matin - avec le même examen minutieux - dans un tampon de sécurité caverneux entre deux immenses grilles de fer. Chaque jour, l'officier supérieur m'assignait un gardien pour la journée, et j'essayais de faire pencher la balance en faveur des plus jeunes gardes, qui étaient les plus détendus et permissifs, m'abandonnant souvent alors qu'ils partaient fumer et discuter avec des amis.
Ils m'ont montré tout ce que je voulais voir à Tihar : des jardins potagers ; cours de yoga; cours d'informatique; sanctuaires à Shiva et Vishnu couverts de jonquilles et d'hibiscus; des cellules de dortoir tapissées de tapis de prière ; des cercles lâches de femmes bavardes penchées sur des métiers à tisser ; une boulangerie pleine d'hommes aux pieds nus de tous âges, en short ressemblant à une couche, pelletant de la pâte dans des fours industriels. J'ai rencontré des Nigérians accusés de trafic de drogue ; Cachemiris accusés d'attentats terroristes à la bombe ; Australiens accusés d'homicide involontaire ; des accusés qui avaient langui en prison pendant des années, attendant toujours une date de procès - les « undertrials » indiens purgent souvent une peine complète pour les crimes dont ils sont accusés avant même d'être jugés, et s'ils sont acquittés, ils n'obtiennent aucun indemnisation pour séquestration.
J'ai tout vu sauf Sobhraj. Personne ne pouvait me dire où il était. Mais un après-midi, après trois semaines de visites d'une journée, j'ai eu de la chance : j'ai eu mal aux dents. Ma gardienne m'a emmenée chez le dentiste de la prison, dans une petite maison en bois avec une trentaine d'hommes alignés dehors, attendant les vaccins contre la typhoïde.
Mon gardien s'est distrait en parlant à une infirmière sur la véranda pendant qu'elle enfonçait la même aiguille dans un bras après l'autre. J'ai demandé aux hommes dans la file d'attente si quelqu'un pouvait apporter un message à Sobhraj, et un Nigérian portant un collier de perles brillantes a pris mon cahier et s'est enfui en courant, revenant après le rendez-vous de mon dentiste. Mon visage était engourdi par Novocain alors qu'il glissait un papier plié dans la poche de mon orange créer .
Je l'ai ouvert quelques heures plus tard, alors que le jeune gardien de la prison 3 me ramenait à mon hôtel sur sa moto. Sobhraj avait écrit le nom et le numéro de téléphone de son avocat avec des instructions pour l'appeler ce soir-là. Au téléphone, on m'a dit de rencontrer l'avocat à neuf heures précises le lendemain matin, dans son bureau du palais de justice de Tis Hazari.
Le palais de justice de Tis Harazi était une merveille, né du front de William S. Burroughs. Un Léviathan en stuc marron, avec un océan de plaideurs, de mendiants, de vendeurs d'eau et de diverses formes étranges d'humanité déferlant à l'extérieur. À une extrémité du bâtiment, un bus renversé, carbonisé à l'intérieur et à l'extérieur, abritait une grande famille de singes vicieux, arrachant avec excitation des excelsior des sièges divisés, criant et se jetant et lançant des excréments sur les passants. Un ravin peu profond séparait le terrain du palais de justice d'une mesa labyrinthique de bunkers de ciment trapus qui servaient d'avocats' des bureaux.
L'avocat était un homme sans os, d'un âge inimaginable, avec une peau sombre et des traits aryens. Il m'a dit de laisser mon appareil photo derrière. Nous nous sommes dirigés vers le tribunal, à travers la foule, et avons monté quelques escaliers jusqu'à une salle d'audience sombre et carrée.
J'ai reconnu Sobhraj dans une file de plaignants, s'approchant un par un du banc d'un juge sikh bilieux portant un turban jaune vif qui buvait pensivement une bouteille de Coca-Cola. L'avocat nous a présenté.

Sobhraj conduit à la prison de Tihar à New Delhi en avril 1977. Photo par REX USA
Sobhraj était plus court que ce à quoi je m'attendais. Il avait un béret de sport incliné sur ses cheveux poivre et sel. Une chemise blanche à fines rayures bleues, un pantalon bleu foncé, des baskets Nike. Léger, bien que le poids qu'il ait pris lui soit allé directement au cul. Il portait des lunettes sans monture qui rendaient ses yeux énormes et humides, les yeux d'un mammifère sous-marin. Son visage suggérait un acteur de boulevard quelque peu effondré autrefois connu pour sa beauté. Il est passé par une morphologie d'expressions « amicales ».
J'évitai ses yeux et fixai sa bouche. Derrière ses lèvres charnues, il avait des dents inférieures déchiquetées et irrégulières, suggérant vaguement la gueule d'un amphibien prédateur. J'ai décidé que je lisais trop dans sa bouche et me suis concentré sur son nez, qui était plus agréablement formé.
Il attendait de plaider sa cause dans un litige trivial d'un type qu'il initiait toujours, principalement pour sortir de prison pour une journée et faire sensation dans les journaux locaux. 'Tu dois attendre dehors' furent les premiers mots qu'il m'a dit. « L'avocat vous montrera. Il m'a accompagné jusqu'à un endroit sous une haute fenêtre rectangulaire de la façade du palais de justice.
Une demi-heure plus tard, le visage de Sobhraj est apparu dans la fenêtre, encadré contre une cellule de détention non éclairée. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a parsemé de questions sur moi-même : qui étais-je, d'où je venais, où suis-je allé à l'université, quel genre de livres ai-je écrit, où j'ai vécu, combien de temps serais-je en L'Inde, un Niagara virtuel de questions furtives sur mes attitudes politiques, ma religion s'il y en a, ma musique préférée, mes pratiques sexuelles. J'ai menti sur tout.
« Où logez-vous à New Delhi ? » il m'a demandé. J'ai marmonné quelque chose à propos de l'hôtel Oberoi. -A-ha, lança Sobhraj. — L'avocat m'a dit que vous l'aviez appelé depuis un hôtel du marché de Channa.
« C'est vrai, mais je déménage à l'Oberoi. Peut-être ce soir!' dis-je avec insistance. J'ai été soudainement frappé par la pensée de l'un des sbires de Sobhraj, dont il y en avait toujours beaucoup à l'extérieur, me rendant une visite surprise et m'impliquant dans un stratagème à l'air innocent qui me mènerait en prison sans aucun laissez-passer. .
Sorti de nulle part : 'Peut-être que vous pourriez travailler avec moi pour écrire l'histoire de ma vie pour les films.' Quelque chose qui ressemblait à la taille d'un noyau de pêche m'a soudainement obstrué la gorge lorsque je lui ai dit que je ne serais en Inde que pour quelques semaines. 'Je veux dire plus tard. Après je suis sorti. Vous pouvez revenir.
Je me suis senti soulagé lorsqu'un journaliste irritant et maladroit s'est approché de la fenêtre et m'a interrompu, même si je soudoyais les gardes de Sobhraj toutes les 15 minutes pour avoir le privilège de lui parler.
Un peu plus tard, Sobhraj est sorti du cachot, menotté par ses poignets et ses chevilles et enchaîné à un soldat titubant derrière lui. Il avait d'autres affaires au fond du palais de justice. J'ai été autorisé à marcher à côté de lui, ou plutôt, il m'a dit de le faire, sans rencontrer aucune objection de ses gardes. Nous avons marché à l'intérieur d'un cercle de militaires, avec des mitraillettes pointées sur nous deux. D'autres prisonniers ayant des affaires judiciaires marchaient simplement main dans la main avec leurs escortes non armées, mais Sobhraj était spécial. C'était un tueur en série et une célébrité majeure. Les gens se sont précipités à travers le cordon sanitaire pour implorer son autographe.
« Maintenant, lui ai-je demandé pendant que nous marchions, avant que Kiran Bedi ne prenne le contrôle de la prison, les gens disaient que vous étiez vraiment responsable de l'endroit. »
« Est-ce qu'elle vous a dit que j'écrivais un livre ? » cracha-t-il. 'À son sujet?'
« Elle a mentionné quelque chose. Je ne me souviens pas exactement.
'Je suis un écrivain. Comme toi. En prison, il n'y a pas grand chose à faire. Lecture écriture. J'aime beaucoup Friedrich Nietzsche.
'Oh oui. Le surhomme. Zarathoustra.
'Oui, exactement. J'ai la philosophie du Superman. Il est comme moi, sans intérêt pour la morale bourgeoise. Sobhraj se pencha, faisant claquer ses chaînes, pour remonter une jambe de pantalon. « C'est comme ça que j'ai dirigé la prison. Connaissez-vous ces petits micro-enregistreurs ? Je me les collerais ici, voyez-vous. Et sous mes manches. J'ai entendu les gardes parler de pots-de-vin, d'amener des prostituées en prison.
Il m'a montré des papiers froissés dans un portefeuille en pâte à modeler qu'il portait dans la poche de sa chemise.
« Ce sont des papiers pour une Mercedes que je vais rendre ici, dit-il en désignant la porte ouverte du bureau. « Cela s'applique à ma caution. Quand je quitte Tihar, je dois leur donner de l'argent.
« Par permission, vous voulez dire... »
« Quand je pars travailler avec Mère Teresa. » Aïe.
— J'ai besoin de te demander quelque chose, Charles, répétai-je aussi fermement que possible. Au cours de notre conversation (dont ce n'est que l'essentiel), j'ai remarqué que Sobhraj avait fait une sorte de collage mental de tout ce que je lui avais dit plus tôt sur moi, et m'en renvoyait des parties, avec divers éléments plausibles. modifications, comme des révélations sur lui-même. C'est une technique standard des sociopathes.
« Voulez-vous aussi mon autographe ? »
« Non, j'aimerais savoir pourquoi vous avez assassiné tous ces gens en Thaïlande ».
Loin de l'effet bouleversant que j'avais espéré, Sobhraj a souri à une blague privée et a commencé à nettoyer ses lunettes avec sa chemise.
« Je n'ai jamais tué personne.
— Et Stéphanie Parry ? Vitali Hakim ? Ces enfants au Népal ?' En vacances de Noël, Sobhraj et Chowdhury, Leclerc en remorque, avaient trouvé le temps d'incinérer deux routards à Katmandou.
« Maintenant, vous parlez de toxicomanes. »
« Vous ne les avez pas tués ? »
« Ils ont peut-être été… » Il chercha le mot approprié. — Euh, liquidé par un syndicat, pour trafic d'héroïne.
« Vous êtes le syndicat ? »
'Je suis une personne. Un syndicat a beaucoup de monde.
« Mais vous avez déjà dit à Richard Neville que vous aviez tué ces gens. Je ne veux pas vous offenser, mais je veux savoir pourquoi vous les avez tués.
'Je viens de te dire.' J'ai senti le temps filer. Je n'ai pas jugé prudent de revoir cette personne, et dès qu'il aurait terminé cette affaire trouble avec la Mercedes, ils l'auraient ramené à Tihar.
— Eh bien, je peux vous en parler d'un, dit-il après un silence pensif. Il s'est penché sur moi en toute confidentialité. L'un des gardes toussa, nous rappelant sa présence. — La fille de Californie. Elle était ivre et Ajay l'a emmenée à Kanit House. Nous savions pour elle, voyez-vous. Nous savions qu'elle était impliquée dans l'héroïne. Il a ensuite raconté comment il avait tué Teresa Knowlton, une jeune femme qui n'avait certainement pas été impliquée dans l'héroïne et avait l'intention de devenir nonne bouddhiste, plus ou moins exactement comme il avait raconté l'histoire à Richard Neville un quart de siècle plus tôt. Son cadavre a été le premier à être retrouvé, en bikini, flottant au large de la plage de Pattaya. D'où le Bikini Killer.
Quand il est arrivé à la fin d'une longue et laide histoire, j'ai dit : « Je ne suis pas vraiment intéressé par la façon dont vous l'avez tuée. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi. Même si vous travailliez pour un syndicat de Hong Kong, il doit y avoir une raison pour laquelle vous et personne d'autre feriez cela.
Un gardien a indiqué que Sobhraj pouvait entrer dans le bureau. Il se leva avec un grand bruit de chaînes. Il fit quelques pas et regarda par-dessus son épaule.
« C'est un secret », a-t-il déclaré, le visage soudain très sérieux. Puis il a disparu, brandissant le titre pour la Mercedes, Iago jusqu'au bout.

Sobhraj lisant sur lui-même dans un journal français à son arrivée à Paris en avril 1997. Photo par REX USA
J'ai pensé que Sobhraj et Chowdhury devaient avoir pris beaucoup de vitesse. J'ai souvent supposé que les Bikini Killings étaient un rituel de mort homoérotique tordu déclenché par la psychose des amphétamines. Je voulais suggérer cela à la police de Bombay, mais comme j'étais moi-même en régime accéléré, j'ai eu la pensée paranoïaque que si j'en parlais, ils pourraient me faire passer un test de dépistage de drogue, juste là dans leur bureau.
Je suis allé rencontrer Madhukar Zende, un commissaire de police étonnamment solide, étrangement félin, qui m'a présenté des ballots de dépositions manuscrites des cohortes de Sobhraj's, griffonnées au stylo ou au crayon, avouant de multiples larcins à Peshawar et Karachi et Cachemire, perpétrés en une frénésie de transit incroyablement rapide. Zende avait arrêté Sobhraj à deux reprises : une fois en 1971 à l'occasion du 42e anniversaire de Zende, après un cambriolage de bijoux à l'hôtel Ashoka de New Delhi, et une fois en 1986, après l'évasion de la prison de Tihar.
Il a parlé de Sobhraj avec une affection ironique, épinglant sa moustache D'Artagnan en se souvenant du début des années 1970, lorsque Sobhraj gardait un appartement sur Malabar Hill et s'est rendu populaire à Bollywood en offrant des Pontiac et des Alfa Romeo volées à un prix avantageux. Pour des escroqueries plus risquées, il a recruté des comparses dans des bars à jus et des auberges de jeunesse sur Ormiston Road, faisant son truc de drogue et de vol aux riches touristes du Taj ou de l'Oberoi près de la porte de l'Inde pour rester en pratique.
— Il s'intéressait aux femmes et à l'argent, soupira Zende. 'Il a laissé une traînée de cœurs brisés partout où il est allé.' En 1971, Sobhraj attendait un appel international au restaurant O'Coqueiro à Goa lorsque Zende, déguisé en touriste, l'a arrêté.
Je me suis assis près de l'endroit où Sobhraj avait été saisi, alors que de minuscules lézards irisés montaient et descendaient les murs vert sauge de l'O'Coqueiro. C'était hors saison à Goa. Les serveurs se tenaient sans but dans la salle à manger comme des gigolos dans une salle de danse vide.
Sur la véranda ombragée, Gines Viegas, le propriétaire, m'a servi du rhum et des coca pendant qu'il racontait ses années comme agent de voyages en Afrique et en Amérique du Sud. C'était une tortue irritable, mais de temps en temps, il insérait de nouveaux détails sur les semaines où Sobhraj se présentait tous les soirs pour utiliser le téléphone au restaurant.
« Il appelait sa mère en France, me dit Viegas. «Il avait l'air différent à chaque fois, portant des perruques, son visage tout maquillé. Il a agrandi son nez avec du mastic. Lorsque Zende était ici pour sa célèbre surveillance, il portait des bermudas et des chemises de touristes. J'ai tout de suite su qu'il était flic.
Madhukar Zende est mort maintenant. Gines Viegas aussi. Charles Sobhraj est toujours en vie.
Les nouveaux propriétaires d'O'Coqueiro ont installé une statue de Sobhraj à la table où il a dîné le soir de son arrestation. Quant à Kiran Bedi, elle a perdu son emploi, victime de l'orgueil et, non de façon imprévisible, de Sobhraj. Cette femme dure s'adoucit sous un tsunami de flatterie du Serpent. Elle croyait si ardemment en sa réhabilitation qu'elle a permis à une équipe de tournage française à Tihar de le documenter, donnant à ses supérieurs une excuse pour la licencier.
Contrairement à ce que disait Zende, je ne croyais pas que Sobhraj se soit jamais intéressé aux femmes ou à l'argent. Malgré tout le bling-bling dont il faisait preuve pour impressionner ses notes, son plaisir de la vie s'imposait à elles. Il n'a jamais reçu plus de quelques centaines de dollars des routards qui se sont présentés à Kanit House et sont morts plus tard. Chaque fois qu'il récoltait une aubaine de son métier, il s'envolait instantanément pour Corfou ou Hong Kong et tout faisait exploser dans un casino. Les femmes de sa vie ont toujours été des accessoires pour une entreprise criminelle, ou de la publicité. Si Charles a jamais été un étalon fabuleux, personne ne l'a jamais dit. Et ils l'auraient fait.

Sobhraj escorté par la police népalaise après une audience devant un tribunal de district de Bhaktapur le 12 juin 2014. Photo AFP/Prakash Mathema/Getty Images
Je ne sais pas pourquoi les Bikini Killings ont eu lieu. Mais dans cette partie du monde, de tels événements étaient autrefois appelés « amok » – un « déchaînement déclenché », observé pour la première fois par des anthropologues en Malaisie à la fin des années 1800. Plus souvent, maintenant, ils se produisent ici aux États-Unis. Eric Harris et Dylan Klebold se sont déchaînés à Columbine. Adam Lanza s'est déchaîné à Newtown, dans le Connecticut. L'événement déclencheur à Bangkok — j'en suis assez certain — a été Ajay Chowdhury. Les meurtres ont composé un très bref chapitre de la vie de crime incroyablement variée de Sobhraj : une explosion prolongée de « surpuissance » par un escroc svelte et imperturbable qui se targuait de sa maîtrise de soi. Les meurtres ont commencé lorsque Chowdhury est entré en scène et se sont arrêtés lorsqu'il l'a quitté.
À la consternation de nombreuses personnes qui ont essayé de l'empêcher, Sobhraj a été libéré de prison un an après que je l'ai rencontré. En tant que ressortissant français avec un casier judiciaire, il a été expulsé à la hâte de l'Inde. Il s'est installé à Paris, où il aurait été payé 5 millions de dollars pour l'histoire de sa vie et a commencé à donner des interviews pour 6 000 $ la pop, dans son café préféré des Champs-Élysées.
Mais ce n'est pas tout à fait fini. En 2003, il est arrivé au Népal, le seul pays au monde où il était encore recherché. (La Thaïlande a un délai de prescription pour tous les crimes, y compris le meurtre.) Il croyait - du moins c'est ce qu'on dit - que les preuves contre lui étaient depuis longtemps tombées en poussière. Je ne suis pas sûr qu'il y ait cru. Il a rugi autour de Katmandou sur une moto, comme il l'avait fait à Goa, se faisant remarquer. Le Népalais avait soigneusement conservé les reçus datés d'une voiture de location et des traces de sang trouvées dans le coffre et a procédé à son arrestation, à juste titre, dans un casino.
Au moment où j'écris ces lignes, je viens de regarder une vidéo YouTube qui montre Sobhraj perdant son dernier appel sur une condamnation pour meurtre à Katmandou. Tant de temps sépare les Bikini Killings du présent que la façon dont il finira n'illustre plus la tendance de certains individus à flageller leur pathologie jusqu'à l'auto-immolation. Ce qu'il illustre, c'est la futilité ultime de tout face au processus de vieillissement. Sobhraj a vieilli. S'il n'est pas fatigué de lui-même maintenant, il est certainement devenu stupide. Si vous regardez son histoire depuis aussi longtemps que je l'ai – la traînée sans fin de mal et de chaos qui n'a conduit qu'à son point de départ, une cellule de prison ; l'argent volé et immédiatement mis au jeu; le mouvement perpétuel inutile à travers les pays et les continents, vous verrez que Sobhraj a toujours été ridicule. La première impression que j'eus de lui face à face fut celle d'un ridicule agressif, implacable.
Ses victimes avaient été des gens de mon âge, errant sans aucun doute sur la terre dans le même brouillard mental que j'avais dans la vingtaine, exactement les mêmes années. L'histoire m'a rappelé il y a longtemps, sans doute, parce que je me suis demandé si, à leur place, j'aurais pu être escroqué à mort par Sobhraj aussi : sur les photographies de cette époque, il ressemblait à une personne avec qui j'aurais couché dans le années 70—comme plusieurs personnes différentes, en fait, avec qui j'ai couché dans les années 70. Il n'y avait aucun moyen de répondre à la question en le rencontrant. Il ne ressemblait plus à personne avec qui j'allais coucher et je savais d'avance ce qu'il avait fait. Un criminel tout à fait comme Sobhraj serait impossible maintenant : Interpol est informatisé ; une personne ne peut pas monter et descendre des avions et traverser les frontières avec rien d'autre que des discours rapides, des sourires sexy et des passeports falsifiés ; toutes les bijouteries du monde ont des caméras de surveillance, et bientôt toutes les rues du monde en auront aussi.
Mais j'ai peut-être tout faux depuis le début, de toute façon. Pendant des années, j'ai imaginé Sobhraj attirant des stoners crédules et pas très brillants dans sa toile de mort par le biais d'un charme sexuel et d'une ruse supérieure. Mais que se passerait-il si les gens qu'il a tués n'achetaient pas plus son numéro que moi, peu importe à quel point il était attirant à l'époque, et même sans rien savoir de lui ? Et si, au lieu d'une image de perfection, ils voyaient un perdant manifestement asiatique, hilarant et louche, comme un ponce dans un costume d'affaires shilling devant un strip-tease, prétendant absurdement être français, ou néerlandais, ou vaguement européen, 'comme eux.' Et s'ils le considéraient d'une manière amusante pathétique mais peut-être utile ? La plupart avaient été « attirés » non pas par son sex-appeal, ou son bavardage gras, mais par la perspective d'obtenir des pierres précieuses chères à bon marché. Il est tout simplement possible que ses victimes aient imaginé qu'elles le bernaient et l'aient trouvé aussi ridicule que moi. Et peut-être croyaient-ils – avec condescendance, avec une indulgence libérale et éclairée – qu'une personne ridicule est aussi une personne inoffensive.